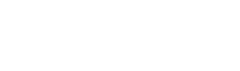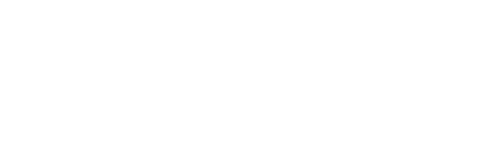Former, transmettre, inspirer

Dans les métiers d’ennoblissement des matières souples, la transmission n’est pas une étape : c’est un fondement.
Geste après geste, ces savoir-faire se perpétuent car des femmes et des hommes consacrent leur temps, leur énergie et leur passion à former, accompagner, guider.
Aujourd’hui, alors que la relève se construit et que les vocations émergent en nombre, la formation occupe une place essentielle pour assurer la continuité et l’avenir de ces métiers d’art. Au sein du collectif Les Ennoblisseurs, elle se vit de multiples façons : dans les écoles, dans les ateliers, dans les reconversions comme dans la pratique amateur.
Trois témoignages — trois approches complémentaires — éclairent cette dynamique :
Pascale Duchénoy de la Maison Duchénoy, Claire Raphaël des Filles d’Hortensia et Soline Du Puy.
La transmission : un socle pour faire vivre le geste
Pour chacune d’elles, la transmission dépasse largement la dimension technique.
Elle touche au rapport à la matière, à l’exigence, à la culture de l’atelier et à la place du collectif.
Pascale Duchénoy intervient régulièrement dans différents jurys — des rendez-vous qu’elle considère essentiels — où elle observe la relève de près : des jeunes motivés, parfois idéalistes, qui mesurent peu à peu combien ces métiers exigent patience, persévérance et sens du détail. Pour elle, « la transmission, c’est le geste, la culture et l’équipe. Les trois sont indissociables ».
Soline initie adolescents en recherche d’orientation, artistes ou professionnels aux bases traditionnelles, avec l’idée qu’elles servent de tremplin à toutes les explorations — détournement de matières, expérimentation, création contemporaine. Certifiée Qualiopi, elle propose par ailleurs des formations professionnelles structurées, qui offrent un cadre d’apprentissage reconnu et adapté aux besoins du terrain. Elle voit naître une véritable “boule de neige” de transmission, lorsque d’anciens élèves deviennent à leur tour formateurs ou accompagnants.
Claire, de son côté, enseigne principalement dans des écoles de mode, où elle familiarise les étudiants avec les techniques d’ennoblissement textile. Son enseignement ressemble à un atelier : apprendre une technique, puis l’élargir, la mélanger, la transformer. Broderie, plissage ou croisement avec d’autres métiers d’art : elle pousse les étudiants à comprendre que la créativité naît justement de cette liberté d’interprétation.


Elle les confronte aussi à des projets concrets, notamment lors des JEMA — Journées Européennes des Métiers d’Art, un événement national dédié à la promotion des métiers d’art, où ses élèves présentent des silhouettes et rencontrent des artisans. Une première immersion dans le monde professionnel qui ancre le geste dans la réalité contemporaine.
Pour toutes les trois, transmettre, c’est faire circuler un geste, une culture et une vision du métier — une manière d’ancrer la tradition dans le présent tout en préparant l’avenir.
Former pour préserver, mais aussi pour transformer
Si la formation est indispensable à la préservation des savoir-faire, elle est aussi un moteur d’évolution. Les formations initiales — CAP, BMA, DNMADE — tiennent un rôle central, mais elles ne sont pas suffisantes à elles seules.
Pascale Duchénoy le rappelle : le référentiel du CAP équivaut plutôt à « cinq années en entreprise ».
La montée en compétence réelle se fait dans l’atelier, au contact d’équipes expérimentées.
Et pour elle, il est essentiel que les formations généralistes continuent d’exister afin que chacun puisse accéder à ces métiers, sans dépendre uniquement des formations internes dispensées par de grandes maisons, souvent très ciblées sur leurs besoins spécifiques.
Soline du Puy constate, quant à elle, que certains volets du référentiel CAP ne correspondent plus aux réalités actuelles : absence d’enseignement lié au travail quotidien en atelier ou manque d’exploration des matériaux nouveaux, par exemple. Elle espère une mise à jour permettant d’aligner la formation nationale avec les attentes des professionnels aujourd’hui.
Claire Raphaël, de son côté, voit émerger une nouvelle génération sensibilisée aux enjeux contemporains : responsabilité, upcycling, nouvelles manières de concevoir les vêtements.
Elle travaille notamment avec des écoles qui explorent des voies alternatives, comme le Studio Lausie, qui inscrit la mode dans une démarche slow et expérimentale.
« Les étudiants doivent sentir que la broderie n’est pas figée. Elle peut aller loin : dans l’architecture intérieure, le design, l’art. »
Accompagner les vocations : entre passion, exigence et réalité
Tous les acteurs de cette filière le savent : ces métiers demandent un fort engagement personnel. Ils exigent de la rigueur, du temps, de la précision, parfois des sacrifices.
Et pourtant, ils offrent un sens, une liberté d’expression et une fierté qui n’ont pas d’équivalent.
« Il faut de la passion. Ce métier ne rend pas riche d’argent, mais riche de sens », résume Pascale Duchénoy. Elle insiste aussi sur l’importance de l’humilité et du réalisme pour les personnes en reconversion : beaucoup sous-estiment la difficulté du geste, la longueur des apprentissages et la nécessité d’être rapidement opérationnel en atelier.
Soline du Puy partage ce constat, notamment pour les jeunes de 16–17 ans en pleine orientation :
« On doit leur transmettre la patience, la persévérance, mais aussi la curiosité. L’inspiration vient des expositions, des livres, de tout ce qui nourrit l’œil. »
 Pour Claire Raphaël, la dimension humaine est tout aussi importante que la dimension technique :
Pour Claire Raphaël, la dimension humaine est tout aussi importante que la dimension technique :
entraide, partage, capacité à travailler ensemble. C’est cette dynamique collective qui permet d’apprendre, de progresser et de trouver sa place.
Pascale souligne enfin le rôle essentiel des concours, notamment le MOF, qui permettent de conserver vivantes des techniques rares et d’offrir une reconnaissance officielle à celles et ceux qui atteignent un niveau d’excellence. Ces échéances nourrissent l’exigence de la filière et donnent un horizon à la nouvelle génération.
Former aujourd’hui pour imaginer demain
L’apprentissage, qu’il soit initial ou continu, est le premier maillon de la chaîne de la création.
Ces artisans de la matière rappellent qu’au-delà de la technique, transmettre, c’est transmettre une culture du travail bien fait, du respect des matières et des personnes.
L’avenir des métiers d’ennoblissement se construit ainsi : geste après geste, main après main, avec celles et ceux qui enseignent, expérimentent, encouragent et inspirent.
Former, c’est semer les gestes de demain. Et dans les ateliers des Ennoblisseurs, chaque main qui apprend prolonge un peu plus la vie d’un savoir-faire.